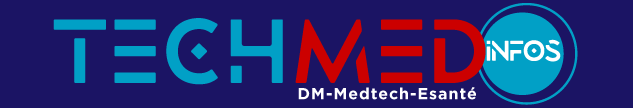
Jeudi 23 novembre 2023

Implants vaginaux : vers un nouveau scandale dans le secteur du DM ?
Les témoignages de complications graves liées à la pose d'implants vaginaux, dans la prise en charge de l’incontinence ou de la descente d’organes, se multiplient. Des dizaines de patientes ont déjà déposé plainte.
L’affaire rappelle l’enquête des « Implant Files » en 2018, qui révélait les lacunes du contrôle de certains implants médicaux en Europe. Les implants vaginaux étaient alors déjà cités parmi ces dispositifs à risque, face aux douleurs rapportées par les patients et un risque de détérioration de leur santé. Dans son édition du 10 novembre, Le Parisien cite de nouveaux témoignages de femmes, comme celui d’Anabela, 54 ans, opérée en juillet 2021 avec la pose d’une bandelette contre l’incontinence, placée sous l’urètre. Après de longs mois d'une souffrance comparée à des coups de poignard, l’implant a finalement été retiré. « La mécanique, ça se répare, mais dans le cerveau, ça ne s’efface pas », explique-t-elle.
Mais le retrait de ces dispositifs est parfois complexe. « À l'heure actuelle, il n'existe pas de centres spécialisés de référence dans lesquels les professionnels de santé seraient formés au diagnostic et à la prise en charge des complications ainsi qu'aux chirurgies d'ablation des implants dans les meilleures conditions, moyennant quoi les victimes se voient dans l'obligation d'aller aux États-Unis pour tenter de les retirer », indique la sénatrice Corinne Imbert, qui appelle le gouvernement à « mettre en place un véritable accompagnement spécifique pour aider davantage ces femmes ».
5 % des patientes concernées
La pose de ces dispositifs, qui se présentent sous la forme de rubans en polypropylène, reste courante face aux besoins médicaux, avec près de 35.000 opérations par an. Toutefois, un arrêté d’octobre 2020 encadre les opérations : la patiente doit être informée des risques, le médecin chevronné, la décision prise par toute une équipe médicale. « Le polypropylène est connu depuis longtemps et plutôt bien toléré », explique le Pr Xavier Gamé, administrateur à l’Association française d’urologie. « Mais le problème vient de la réaction de l’organisme qui identifie parfois ces implants à un corps étranger. Le muscle, à travers lequel ils passent, va se contracter sur la bandelette, voilà pourquoi certaines femmes n’arrivent plus à lever la jambe ou à s’asseoir. »
De nombreuses femmes interrogées indiquent toutefois ne pas avoir été suffisamment informées des risques. « Comment se fait-il que la loi ne soit pas respectée ? Qu’on nous opère, qu’on nous brise, qu’on nous rende handicapées à cause d’une intervention de quinze minutes ? » alerte Anabela, qui a déposé plainte auprès du parquet de Paris. Près d’une centaine, pour « tromperie aggravée et blessures involontaires », serait lancée. Un chiffre qui pourrait rapidement augmenter, alors que selon le professeur et gynécologue Xavier Fritel, 5 % des opérations entraînent des complications. « La moitié des patientes voient leur état s’améliorer après une deuxième opération, mais 20 % restent en mauvaise santé avec un handicap qu’elles attribuent aux complications. » Si les données manquent, le spécialiste estime en outre « probable » que certains modèles de bandelettes soient plus problématiques que d’autres.

Les médecins freinent l'essor de la téléconsultation
Entre polémique sur les téléconsultations dans les gares et refus des syndicats de revaloriser leur tarif, la téléconsultation n'a plus la cote chez les médecins, qui redoutent qu'elle détourne les praticiens de l'accueil direct en cabinet.
SNCF Gares et Connexions a présenté vendredi son plan pour équiper 300 gares d'espaces de télémédecine d'ici à 2028. Un chiffre en deçà du projet présenté fin juin, qui portait sur 1.735 télécabines, mais qui a quand même surpris les syndicats de médecins. « Je pensais cette affaire enterrée, le ministère de la Santé ayant désapprouvé ce qui n’est pas autre chose qu’une ubérisation de la santé », indique Franck Devulder, président de la CSMF. Dans un rapport présenté cet été, l’Assurance-maladie appelle en effet le gouvernement à n’autoriser l’implantation des cabines de téléconsultation médicale que dans le lieu d’exercice d’un professionnel de santé, comme les pharmacies. Elle pointe sinon le risque d’ « une dégradation de la qualité » des diagnostics, « en l'absence d'examen clinique poussé ou de téléconsultation assistée », et fait valoir que les téléconsultations « peuvent perturber les modèles de soin traditionnels ». Selon la Cnam, la téléconsultation est en outre associée à des dérives qui méritent d’être encadrées : surprescription d’arrêts de travail et d’antibiotiques, facturation de frais supplémentaires sans rapport avec le soin, etc.
Un avis partagé par l’Ordre des médecins. « Ces box de téléconsultation vont mobiliser des médecins et des infirmiers, qui, en temps normal, se seraient installés dans des cabinets médicaux classiques, parfois même dans des territoires reculés », s’inquiète dans La Croix son vice-président, Jean-Marcel Mourgues. « Déjà que cette installation est de moins en moins attractive, les box vont encourager ces professionnels de santé à faire le choix de se salarier, ce qui va alimenter le manque cruel de médecins traitants dans les zones en tension. » Il pointe également le risque de complexifier davantage la coordination du parcours de soins par le médecin traitant. « Le nouvel espace numérique santé constitue aujourd’hui un véritable défi pour l’exercice médical. La multiplication des consultations de télémédecine signifie davantage de dépôt de documents médicaux dans cet espace, et donc un travail supplémentaire pour le médecin traitant. »
Vers une tarification différente ?
Du côté des syndicats également, l’heure est aux doutes. MG France, principal syndicat de médecins généralistes, s'oppose ainsi à la revalorisation du tarif des téléconsultations dans le cadre des actuelles négociations conventionnelles. « Il ne faut pas que les tarifs des téléconsultations augmentent », indique sa présidente, Agnès Giannotti. Ils pourraient ainsi s’afficher à un prix inférieur à la consultation de base, après sa revalorisation attendue lors de ces négociations. Le syndicat réclame en outre un contrôle accru de l'activité et de la facturation des plateformes de téléconsultation.
Pour les entreprises du secteur, déjà marquées par les polémiques sur les offres d’abonnement à la téléconsultation, un changement d’horizon semble nécessaire pour intégrer pleinement la pratique dans les soins. « Le système parfait d’un parcours de soins coordonné, à savoir un patient suivi par un médecin traitant dans un cabinet médical, est aujourd’hui mis à mal par le manque de professionnels de santé », souligne Jean-Pascal Piermé, président de l’association Les Entreprises de télémédecine (LET). « Ne pas imaginer de solution de rechange à ce système est illusoire, et les espaces de télémédecine comme ceux que va accueillir la SNCF nous paraissent être une solution intéressante. »
En bref
Le Conseil européen de l'innovation a approuvé la création d’un fonds d’un milliard d'euros pour investir en capital-risque dans les technologies de pointe sur une durée d’un an. Le secteur de la medtech est notamment ciblé, avec des acteurs comme le néerlandais Microsure, leader de l'innovation dans le domaine de la microchirurgie assistée par robot, qui a obtenu un financement de 38 millions d'euros pour finaliser le développement de son tout dernier robot microchirurgical en vue d'études cliniques.
Le Moniteur des Pharmacies s'interroge sur le contenu de la lettre de cadrage des prochaines négociations conventionnelles avec l'officine. Elle devrait faire la part belle aux nouvelles missions. "Pour moi, la pharmacie de demain, c’est plus les Trod et les bilans de médication que les crèmes solaires", a souligné le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, lors de la 35e Journée de l’Ordre national des pharmaciens. Il s'est en outre engagé pour la sortie prochaine du décret sur la réforme du 3e cycle de pharma.
Le CHU de La Réunion est le premier hôpital de France à s’équiper du TEP SCAN, une technologie d’imagerie de pointe. "Il n’y a que 20 tomographes à émission de positrons (TEP), dans le monde entier et le seul installé en France est installé au CHU de La Réunion", se félicite Lionel Calenge, directeur du CHU de La Réunion. Cette technologie d’imagerie de pointe permet un diagnostic précoce et précis du cancer. (La 1re)

Vincent Gardès, directeur général de Germitec

Spécialiste de l'hygiène hospitalière, Germitec vient d’obtenir un prêt en trois tranches de 25 millions d'euros de la BEI, dans le cadre du programme InvestEU. La société bordelaise entend ainsi accélérer le déploiement de son dispositif de désinfection des sondes d’échographie à l'international, notamment aux États-Unis, où un feu vert de la FDA est attendu en 2024.
Comment Germitec a-t-elle évolué depuis sa création ?
Germitec est une « start-up mature » de santé, créée il y a 18 ans déjà. « Start-up », car après de nombreuses années de développement, elle est désormais prête à accélérer pour prendre toute sa place en tant que medtech internationale. Nous répondons à l’enjeu clé de la lutte contre les infections nosocomiales, grâce à un dispositif qui utilise les propriétés fongicides et germicides des rayonnements ultraviolets C pour désinfecter efficacement les dispositifs médicaux, en particulier les sondes d’échographies endocavitaires, pour lesquels le risque infectieux est particulièrement élevé. Donc dans un premier temps la société s’est développée au rythme de ses investisseurs, notamment de sa famille fondatrice, qui est aujourd’hui encore son actionnaire majoritaire. Le défi était élevé, car au-delà de la maîtrise et de la validation de cette technologie d’UV-C, il faut rappeler que les sondes d'échographie, en tant qu’outil de diagnostic efficace et peu invasif, comptent de nombreux fabricants à travers le monde. Plus de 1.000 modèles sont sur le marché, avec des géométries très différentes. Nous avons donc réalisé un énorme travail de compatibilité de notre dispositif pour nous assurer de son efficacité auprès de si ce n'est toute au moins la grande majorité des sondes. Nous avons donc passé la phase d’amorçage, de R&D, des brevets, la phase réglementaire aussi avec le marquage CE et tout est prêt aujourd’hui pour transformer cette start-up technologique en entreprise internationale.
C’est donc dans ce contexte que vous avez frappé à la porte de la BEI pour obtenir un prêt ?
Il y a en effet le contexte de l’entreprise, mais aussi celui plus général de l’économie. L’ambiance, du côté des investisseurs, est plus morose. Et même si nous gardons le soutien de nos actionnaires, il est difficile de lever d’importants montants sans une activité commerciale déjà solide. Donc, nous avons en effet porté ce projet auprès de la BEI en début d’année. J’étais au départ moi-même un peu sceptique, craignant de perdre un temps précieux alors que sur 1.500 candidatures, seule une trentaine de dossiers sont retenus chaque année. Germitec est par ailleurs une entreprise installée en région, sur un secteur un peu moins à la mode que l’IA. Mais finalement la BEI est aussi bien impliquée dans le domaine de la santé. Avoir un chiffre d’affaires – 6.5 millions l’an dernier pour Germitec et 10 millions attendus l’année prochaine – est un point positif, mais pas déterminant. Le plus important, pour la BEI, est finalement de soutenir un projet « made in France », créateur d’emplois et d’exports, avec une composante environnementale et innovation forte. Pour nous, il s’agit donc de la lutte contre les maladies nosocomiales, qui est un enjeu clé à l'hôpital.
Les difficultés financières des hôpitaux risquent-elles de freiner l’adoption d’innovations, comme celle de Germitec ?
Notre mission au quotidien est d'être un partenaire de santé des hôpitaux et des cliniques. Notre solution limite le risque nosocomial pour les patients, mais elle améliore aussi la qualité de travail des soignants. En dehors de cet outil, ils doivent en effet nettoyer eux-mêmes les sondes en les plongeant dans des produits détergents ou en les frottant pendant 10 minutes avec des lingettes. C’est une tâche pénible et du temps en moins à consacrer aux patients, alors que notre solution permet une désinfection du matériel en 90 secondes. Les risques nosocomiaux constituent une préoccupation grandissante au sein des hôpitaux. En effet, depuis les immenses progrès réalisés au XXe siècle, la situation stagne aujourd’hui, avec 750.000 infections rapportées chaque année et plus de 4 000 décès. Mais effectivement, les hôpitaux font face à un impératif d’économies important, qui peut freiner les investissements. À nous de les convaincre en mettant aussi en avant l’intérêt environnemental de notre solution, qui réduit aussi l’usage des produits chimiques et des lingettes jetables. Pour notre croissance, nous comptons beaucoup sur les États-Unis, qui ont une approche un peu différente. Alors que la France s’appuie sur des recommandations et de bonnes pratiques d'hygiène, la stérilisation a été érigée en loi outre-Atlantique avec l’obligation pour les hôpitaux d’assurer une traçabilité, au risque sinon, en cas d’accident, de faire face à la justice.

BioSerenity sort de son redressement grâce à Jolt Capital
Membre du FT120, indice phare de la French Tech, et grand nom des start-up françaises de la medtech, BioSerenity est sauvée de la liquidation par Jolt Capital pour 24 millions d’euros.
BioSerenity, qui figurait l’an dernier encore parmi les medtech françaises les plus prometteuses, va-t-elle retrouver de sa superbe sous la direction de Jolt Capital ? Placée en redressement judiciaire courant août à cause d’une chute de son activité à 47,7 millions d'euros en 2022, contre 58,9 millions en 2021, la société annonce en effet sa reprise pour 24 millions d’euros par le fonds français. « Lorsque BioSerenity a été placée en redressement judiciaire, nous avons été avertis de l’opportunité par nos avocats. C’est une excellente société, avec un socle propriétaire de technologies de pointe éprouvé et qui a déjà très bien pénétré le marché français », explique le président de Jolt, Jean Schmitt. Il espère désormais remettre l’entreprise sur les bons rails pour la revendre dans quelques années à 100 ou 150 millions d'euros.
Côté opérationnel, Jolt Capital assure qu’une « grande partie » des 300 salariés de BioSerenity sont repris. Le fonds va en outre injecter 20 millions supplémentaires dans l’entreprise et recentrer son activité. « BioSerenity a développé beaucoup de produits intéressants, mais il y en avait trop. Il aurait fallu se focaliser sur quelques-uns », observe Jean Schmitt. Il entend par ailleurs mettre l’accent sur la distribution internationale des produits, étendre la partie télé-interprétation en France et à l'étranger et n'exclut pas de faire des acquisitions « pour aller plus vite ». BioSerenity fabrique notamment le « Neuronaute », un vêtement intelligent et connecté associé à un bonnet, équipé de capteurs biométriques et relié à un logiciel de télé-interprétation. Il permet un accès simplifié à l’activité du cerveau et est notamment utile au diagnostic et au suivi des patients épileptiques.
Le syndicat des fabricants français de masques sanitaires (F2M) met en garde contre une disparation de la filière, battue en brèche par une concurrence chinoise toujours aussi forte. "En 2021 et 2022, plus de 90% des appels d'offres hors santé ont été attribués à des importateurs", dénonce la F2M, et ce malgré la publication en janvier 2022 d'un guide des achats publics et privés prévoyant des critères de préférences européennes et intégrant les enjeux environnementaux. La moitié des entreprises ont d'ores et déjà mis la clé sous la porte, précisent Les Échos.
VistaCare Medical, qui développe un concept de cicatrisation des plaies complexes, s'est placé en redressement judiciaire suite à la rupture des négociations exclusives annoncées le 20 juillet avec Quantum Genomics, rapportent Les Échos. Bénéficiant d'un marquage CE depuis 2018, son dispositif consiste en une enceinte de confinement de la plaie permettant de contrôler trois paramètres (le volume d'oxygène, la température et l'hygrométrie) et ainsi de réduire le temps de cicatrisation.
Spécialisée dans les dispositifs médicaux de télésurveillance pour les pathologies chroniques respiratoires, la société rennaise Biosency vient de lever 7 millions d’euros. Elle compte ainsi poursuivre la commercialisation et le développement de son bracelet Bora Band, qui a obtenu le marquage CE en 2020. Ce bracelet, intégrant des capteurs, remonte des données vitales à une plateforme d’analyse développée par la start-up. (L’Usine Digitale)
Smith & Nephew annonce l’acquisition du fabricant de dispositifs médicaux CartiHeal pour un montant initial de 180 millions de dollars, et jusqu’à 150 millions de dollars en paiements basés sur la performance. L'acquisition vise à compléter le portefeuille existant de réparation du genou de la société britannique de technologie médicale, avec l'intégration de l'Agili-C de CartiHeal, un nouveau traitement pour la régénération du cartilage dans le genou.
Fresenius Kabi a inauguré vendredi dernier le nouveau bâtiment de 3.300 m2 de son site de Louviers (Eure). Baptisé "Aux Portes de l’eau", il accueille deux nouvelles lignes de production de poches à perfusion, indique La Dépêche. Ce sont ainsi 80 millions de poches qui peuvent désormais être produites chaque année à Louviers. Elles permettent de couvrir 50% des besoins annuels des hôpitaux français, tout en servant une partie du marché pharmaceutique international.
Aux prises avec les régulateurs européen et américain, Illumina s’est finalement résolu à étudier différentes options pour sa filiale Grail. Le groupe prévoit sa vente ou sa mise en Bourse. Il serait déjà en contact avec des sociétés de capital d'investissement ou des acheteurs potentiels. (MedTech Dive)
↪ 10 dispositifs médicaux sont en lice pour le prix Galien 2023. Ils sont à retrouver ici.

- Le Forum DMDIV du Gmed se tiendra le 9 novembre et le Forum DM le 28 novembre 2023, à Paris.
- La deuxième édition du CHU X HealthTech Connexion Day se tiendra à Marseille le 20 novembre.
- Le Snitem organise le 30 novembre un Afterwork des métiers du DM.
- Les Journées nationales de xhirurgie ambulatoire se tiendront les 4 et 5 décembre 2023 (JAB 2023) au Palais des Congrès d’Issy-Les-Moulineaux.
- Le pôle de compétitivité Medicen Paris Region et l’Académie nationale de chirurgie organisent les 7 et 8 décembre le Congrès Chirurgie 4.0 à Paris.
- Le 36e congrès francophone de rhumatologie (SFR 2023) se tiendra du 10 au 12 décembre à Paris.
Newsletter hebdomadaire N°52 - Jeudi 23 novembre 2023
© PR Editions
Newsletter réalisée par Fabien Nizon
Directeur Général et Directeur de la Publication : Pierre Sanchez
AVERTISSEMENT
Cet exemplaire de la revue de la newsletter TechMed Infos est strictement réservé à son destinataire et protégé par les lois en vigueur sur le copyright.Toute reproduction et toute diffusion (papier ou mail) sont rigoureusement interdites, sauf accord écrit de l'éditeur.
Nous vous rappelons que conformément à la loi Informatique et libertés vous disposez d'un droit d'accès et de rectification relativement aux informations vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en écrivant à l'adresse suivante :
PR Editions, Tour D2, 17 Bis Place des Reflets, TSA 64567, 92099 La Défense Cedex.
Je souhaite me désabonner de la newsletter